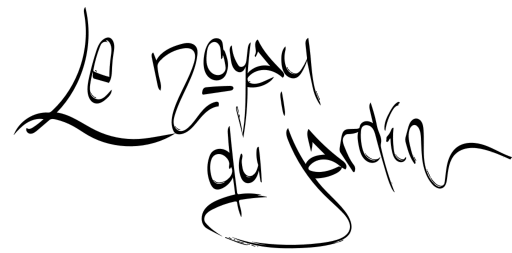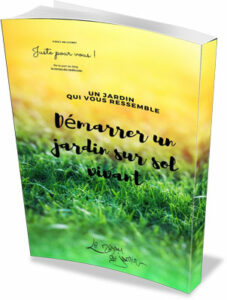Alors que nous cherchons tous désespérément à avoir des tonnes de vers de terre dans nos jardins et dans nos champs pour améliorer notre sol vivant, un drame est peut-être en train de se produire ailleurs sans que nous ne nous en doutions.
En effet, dans certaines régions du Canada, ces petits invertébrés pourraient représenter une menace insoupçonnée pour l’environnement.
La forêt boréale canadienne
Dans cet article
ToggleLa forêt boréale canadienne (ou forêt bleue) possède un des écosystèmes le plus riche et le mieux conservé au monde.
Elle héberge entre autre une centaine d’espèces d’arbres (dont pins, mélèze laricin, épinettes, et sapins, trembles…).
Or, une étude récente révèle que la prolifération des vers de terre européens dans la forêt boréale pourrait accélérer les changements climatiques en modifiant profondément le sol forestier.
Une histoire récente sous nos pieds
L’histoire des vers de terre en Amérique du Nord est étonnante.
La plupart des espèces locales avaient disparu lors de la dernière glaciation, il y a plus de 10 000 ans.
Ce n’est qu’au XVIIIᵉ siècle, avec l’arrivée des colons européens, que les vers modernes ont été réintroduits, probablement transportés dans la terre de plants de jardin comme les tomates.
Depuis, ils se sont progressivement répandus, transformant le sol et les écosystèmes qu’ils rencontrent.
Une étude révélatrice
Une étude récente menée en Alberta et au Québec montre que les vers de terre européens, introduits par les colons il y a trois siècles, menacent aujourd’hui la forêt boréale canadienne et son rôle crucial dans la régulation du climat :
En effet, entre 2018 et 2019, des chercheurs ont étudié l’impact des vers de terre dans différentes régions du Canada, en Alberta et au Québec.
Alors que certains sols du Québec, plus acides, semblaient théoriquement moins favorables à leur expansion, les scientifiques ont constaté que les vers de terre étaient bien présents et en pleine activité, élargissant leur aire de répartition vers le nord de la forêt boréale.
Aujourd’hui, ils occupent déjà environ 10 % de cette forêt, et leur présence pourrait s’étendre à la majorité du territoire d’ici 2050.
L’humus en danger
Le problème majeur réside dans le comportement alimentaire des vers de terre.
L’humus : cœur fragile de la forêt boréale
L’humus de la forêt boréale peut atteindre 10 à 15 cm d’épaisseur. Il est constitué de mousse, de feuilles mortes et de débris d’arbres, accumulés lentement sur des siècles. Ce matériau est un réservoir de carbone majeur, stockant des molécules organiques qui, sinon, se retrouveraient sous forme de CO₂ dans l’atmosphère.
Contrairement aux sols agricoles ou tempérés, où les vers améliorent l’humus en l’enrichissant et en le mélangeant avec le sol, dans la forêt boréale, leur action est destructrice. Les vers ingèrent l’humus et le mélangent au sol minéral, réduisant son épaisseur et sa capacité à stocker le carbone.
Cette perturbation libère du CO₂ et menace ainsi le rôle climatique de ces forêts (par dé-séquestration du carbone).
Mais les conséquences vont au-delà du carbone. Les mouvements des vers dans le sol perturbent également les communautés microbiennes et végétales, essentielles à la santé de l’écosystème forestier.
Les effets à long terme de cette perturbation restent encore mal compris, notamment parce que l’apparition des vers européens dans la forêt boréale est relativement récente.
Limiter la propagation : un geste simple mais crucial
Si les vers de terre ont un rôle écologique positif dans certaines situations — ils facilitent la libération d’azote et de phosphore, minéraux essentiels pour les plantes — leur propagation incontrôlée dans les forêts boréales pose un réel danger.
L’étude met en avant un exemple concret : les pêcheurs transportent parfois des vers comme appâts et les laissent sur place après leurs sorties. Une fois relâchés, ces vers se dispersent rapidement dans le sol, et aucun moyen connu ne permet de stopper cette propagation.
Une action simple, mais efficace, consiste donc à demander aux pêcheurs de remporter leurs appâts non utilisés.
Cette mesure permettrait de limiter l’expansion des vers et de protéger la forêt boréale.
Une nouvelle menace à l’horizon
La vigilance est d’autant plus nécessaire que de nouvelles espèces de vers de terre, venues d’Asie et surnommées « vers sauteurs » en raison de leur taille et de leur activité, pourraient prochainement envahir ces écosystèmes.
Ces espèces sont plus voraces et actives, ce qui pourrait aggraver l’impact écologique.
En effet, le ver sauteur asiatique Amynthas agrestis (et les autres Amynthas/Metaphire, dits « jumping worms ») n’a pas du tout le même régime alimentaire ni le même rôle écologique que nos vers de terre européens (comme Lumbricus terrestris ou Aporrectodea).
Comment il se nourrit :
Contrairement à nos vers de terre tempérés qui ingèrent la litière (feuilles mortes, débris végétaux) en la mélangeant à la terre pour digérer surtout les micro-organismes (bactéries, champignons) qui la colonisent,
Amynthas agrestis attaque directement la litière fraîche. Il racle, avale et fragmente les feuilles mortes entières, sans attendre que les champignons et bactéries les aient partiellement décomposées.
Il digère donc une bonne partie de la matière organique elle-même, mais profite aussi des microbes associés.
Conséquences écologiques :
Ils réduisent la couche de litière forestière à une vitesse impressionnante → le sol se retrouve nu, exposé, ce qui change tout l’écosystème.
La microfaune et la mycorhization des arbres en pâtissent, car ces vers détruisent la “banque” de champignons et de bactéries symbiotiques.
En bref, là où nos vers de terre sont des “transformateurs progressifs”, eux sont des “consommateurs rapides” qui court-circuitent la succession naturelle de décomposition.
En somme :
Ils ne se contentent pas d’ingérer les microbes comme nos vers tempérés (non, nos vers de terre européens ne « mangent » pas la terre).
Ils consomment directement les feuilles mortes (matière organique relativement fraîche), tout en absorbant les microbes présents.
Conclusion
Alors que les vers de terre sont souvent considérés comme des alliés dans nos jardins, leur présence dans la forêt boréale canadienne pourrait s’avérer problématique.
Dans la forêt Boréale, en détruisant l’humus et en perturbant les sols, ils accélèrent la libération de CO₂ et modifient l’équilibre écologique.
Il est donc crucial d’agir dès maintenant pour limiter leur propagation, en commençant par des gestes simples comme ne pas laisser sur place les appâts de pêche non utilisés.
Protéger la forêt boréale,
c’est aussi contribuer à la lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale.
Mais alors,
pourquoi est-ce que nos vers européens ne sont pas un problème en Europe ?
Référence scientifique :
Lejoly J., Quideau S., Laganière J. (2021). Invasive earthworms affect soil morphological characteristics. Geoderma.
En effet, on peut se poser la question
En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette différence :
1. La Coévolution avec les écosystèmes européens
Dans la nature, et ce, dans beaucoup de domaines, une espèce n’agit jamais seule : ses effets sur l’écosystème dépendent de millions d’années de coévolution avec les plantes, les sols, les microbes et les autres animaux.
Hors de ce contexte, le même organisme peut devenir perturbateur.
En Europe, nos vers font partie des écosystèmes depuis très longtemps.
Les sols forestiers européens ont évolué avec cette espèce :
l’humus, les champignons, les bactéries et la végétation se sont adaptés à son activité.Les vers consomment la litière, mais cette action ne détruit pas l’humus ni ne provoque de libération massive de carbone, car l’équilibre sol-végétation-microbes est ancien et stable.
2. L’humus est différent
Dans les forêts européennes tempérées, l’humus est plus mince et se renouvelle plus vite.
Les vers améliorent le sol en mélangeant matière organique et minéral, favorisant la croissance des plantes et le cycle des nutriments.
Les écosystèmes européens sont donc résilients à l’activité des vers ; ils participent même à la fertilité des sols.
3. Les espèces locales sont adaptées
Les plantes, champignons et micro-organismes européens tolèrent et profitent de l’activité des vers.
Il existe des prédateurs et des compétiteurs naturels qui régulent les populations de vers et limitent leur expansion.
4. Absence de “nouveauté” écologique
En Amérique du Nord, la forêt boréale n’a pas coévolué avec ces vers.
L’humus boréal est épais et fragile, accumulé sur des siècles dans un climat froid.
L’arrivée de nos vers perturbe cet équilibre : l’humus est mélangé au sol minéral, libérant du carbone et modifiant la composition du sol.
Ce décalage historique et écologique est la raison pour laquelle son comportement est destructeur dans la forêt boréale canadienne, alors qu’il ne l’est pas dans son habitat d’origine.
Qu'en pensez-vous ?
Dans les jardins et les sols tempérés, les vers de terre améliorent le sol en aérant et en mélangeant la matière organique avec le minéral, ce qui enrichit l’humus.
Mais la situation est différente dans la forêt boréale canadienne : là, l’humus est une couche épaisse et fragile, formée depuis des siècles par les mousses, les feuilles et les débris d’arbres.
Les vers européens, en l’ingérant, mélangent l’humus avec le sol minéral et le transforment, ce qui détruit ce réservoir de carbone stocké et libère du CO₂ dans l’atmosphère.
Donc, les vers sont bons pour certains sols, mais dans ce contexte précis, ils deviennent destructeurs.
Le saviez-vous ?
J’aimerais connaitre votre réflexion sur ce sujet