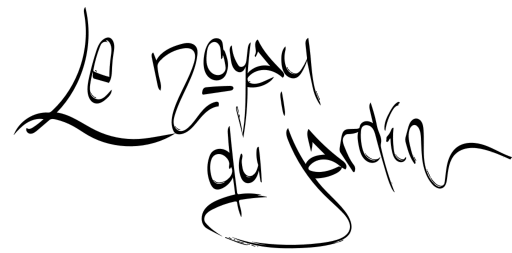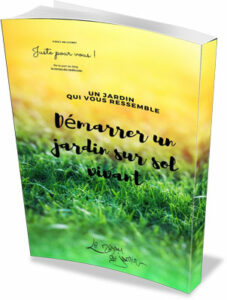Ni animal ni végétal, connaît-on vraiment les champignons, ces acteurs invisibles, mais indispensables à la régulation du climat et à la santé des écosystèmes ?
Avez-vous déjà entendu parler des mycorhizes ?
Si le terme ne vous est pas familier, je vous invite à commencer par cet article qui en donne une explication simple avant de plonger dans celui-ci.
Nous allons découvrir qu’un groupe de scientifique s’est penché sur le problème et a cré un « atlas souterrain » qui représente les « routes » des champignons.
Pourquoi ?
Comment ?
Prenons le chemin des champignons.
Plongée dans l’invisible : les champignons qui font respirer la planète
Dans cet article
ToggleQui est cette
« société des explorateurs du sol ? »
La Société pour la protection des réseaux souterrains (SPUN) regroupe plus de 400 scientifiques et une centaine d’explorateurs passionnés par ce qui se passe… sous nos pieds. Leur terrain d’étude : la biodiversité fongique mycorhizienne, ces champignons qui tissent des réseaux souterrains essentiels à la vie des plantes.
Depuis 2021, ces chercheurs parcourent près de 80 pays – de la Mongolie au Bhoutan, du Pakistan à l’Ukraine – pour collecter des échantillons et créer la première carte mondiale de la biodiversité mycorhizienne souterraine, publiée dans la prestigieuse revue Nature. Cet « Atlas souterrain » offre une résolution au kilomètre carré et pourrait changer notre manière de penser la conservation de la planète.
Des champignons aux super-pouvoirs
Les champignons mycorhiziens ne se contentent pas de vivre dans le sol : ils tissent de véritables autoroutes souterraines. Leurs filaments, appelés hyphes, s’étendent sur des kilomètres sous nos pieds et forment ce qu’on appelle le réseau mycorhizien.
Ce réseau a plusieurs fonctions vitales :
Échange de nutriments : les hyphes captent l’azote, le phosphore et d’autres minéraux dans le sol et les transmettent aux plantes. En échange, elles reçoivent des sucres produits par la photosynthèse.
Communication entre plantes : ces filaments servent de « internet végétal », permettant aux plantes de s’alerter mutuellement contre les maladies ou les attaques d’insectes.
Stockage de carbone : les mycorhizes aident à fixer le carbone dans le sol, participant ainsi à la régulation du climat mondial.
Stabilité du sol : en tissant des mailles autour des particules de terre, elles améliorent la structure du sol et facilitent la circulation de l’eau et de l’air.
On peut imaginer ce réseau comme un grand réseau urbain souterrain, avec des routes, des voies rapides et des ponts, mais à l’échelle microscopique et écologique. Chaque plante n’est pas isolée : elle est connectée à un vaste écosystème vivant et interactif. En perturbant ce réseau – par le labour intensif, les pesticides ou la déforestation – on fragilise tout l’écosystème, du sol jusqu’aux arbres et aux cultures qui en dépendent.

Une carte pour sauver le sol
Pour dresser cet atlas, les chercheurs ont analysé 2,8 milliards de séquences d’ADN provenant de 130 pays, en utilisant l’intelligence artificielle pour relier la diversité fongique aux facteurs environnementaux.
Résultat : plus de 90 % des écosystèmes mycorhiziens les plus riches ne sont pas encore protégés.
Mais désormais, grâce à ces cartes, il est possible de repérer les points chauds de biodiversité – comme les montagnes du Simien en Éthiopie ou la savane du Cerrado au Brésil –, de réfléchir à des corridors de conservation souterrains et de guider les projets de restauration écologique.
Alors que jusqu’ici, les efforts se concentraient presque uniquement sur la vie à la surface.
Urgence : la biodiversité menacée
Certains sites sont particulièrement vulnérables.
La côte ghanéenne, par exemple, s’érode de deux mètres par an. Les scientifiques alertent : si rien n’est fait, cette biodiversité souterraine cruciale pourrait disparaître sous les flots.
Une révolution silencieuse, mais vitale,
pour protéger notre planète… depuis ses racines.
Grâce à l’Atlas souterrain, la biodiversité mycorhizienne pourrait bientôt devenir aussi fondamentale que les images satellites pour la prise de décision environnementale.
Le saviez-vous ?
Actuellement, 90% des points importants de biodiversité mycorhizienne sont situés dans des zones non protégées